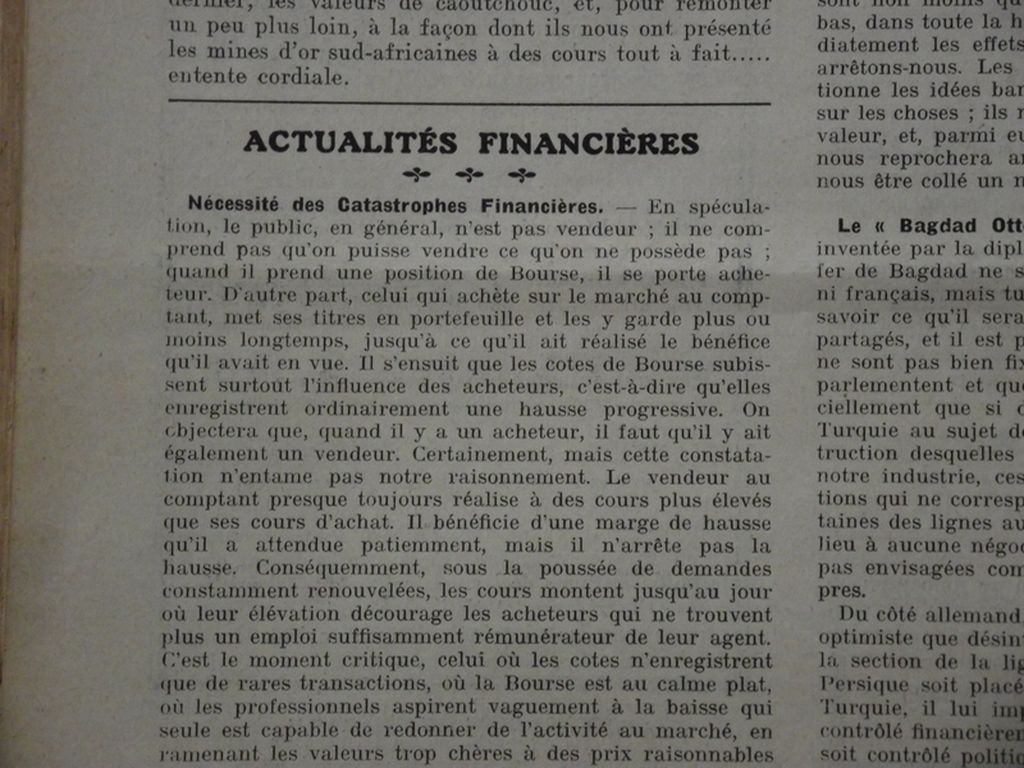En spéculation, le publique, en général, n’est pas vendeur ; il ne comprend pas que l’on puisse vendre ce que l’on ne possède pas ; quand il prend une position de Bourse, il se porte acheteur. D’autre part, celui qui achète sur le marché au comptant, met ses titres en portefeuille et les y garde plus ou moins longtemps, jusqu’à ce qu’il ait réaliser le bénéfice qu’il avait en vue. Il s’en suit que les cotes de Bourse subissent surtout l’influence des acheteurs, c’est à dire qu’elles enregistrent ordinairement une hausse progressive. On objectera, que, quand il y a acheteur, il faut également qu’il y est un vendeur. Certainement, mais cette constatation n’entame pas notre raisonnement. Le vendeur au comptant presque toujours réalise à des cours plus élevé que ses cours d’achats. Il bénéficie d’une marge de hausse qu’il a attendu patiemment, mais il n’arrête pas la hausse.
Conséquemment, sous la poussé de demandes constamment renouvelées, les cours montent jusqu’au jour où leur élévation décourage les acheteurs qui ne trouvent plus un emploi suffisamment rémunérateur de leur argent. C’est le moment critique, celui où les cotes n’enregistrent que de rares transactions, où la Bourse est au calme plat, où les professionnels aspirent vaguement à la baisse qui seule est capable de redonner de l’activité au marché, en ramenant les valeurs trop chères à des prix raisonnables et qui tenteront les acheteurs.
Si une catastrophe ne se produit pas, ce qui est le cas le plus fréquent, on exagère la portée des nouvelles pessimistes, on tire des moindres événements extérieurs ou intérieurs des déductions alarmantes, d’instinct on fait tout ce qu’il faut pour semer la panique, car on sait que plus la baisse sera profonde, plus la reprise des affaires s’accentuera. Mais l’idéal que, dans le fond de l’âme, on redoute et on désire à la fois, c’est la catastrophe, celle qui provoquera 10, 20, 30 Francs de baisse sur toutes les valeurs de la cote…
Au surplus, ce n’est pas seulement en finance que les catastrophes sont nécessaires, nous dirions presque souhaitables.
L’expérience nous a appris qu’après les guerres se produit presque toujours une longue période de prospérité. Quand une grande épidémie, choléra ou peste, a décimé une forte partie de la population sur laquelle elle exerce ses ravages, ceux qui survivent voient s’améliorer leurs conditions d’existence ; et cela se comprend puisqu’ils sont beaucoup moins à se partager les choses qui rendent la vie moins dure. De même, si dans les centres populeux où s’entassent, en de misérables réduits, une trop grande quantité d’êtres humains, un mal contagieux pratique de larges vides, l’état sanitaire s’améliore aussitôt parmi ceux qui ont résisté.
Malheureusement, les catastrophes sont aveugles, elles sévissent sur les habitants sans distinction de classe.
Pour que leur efficacité soit portée à son maximum, il faudrait qu’elle frappe exclusivement les têtes de ligne.